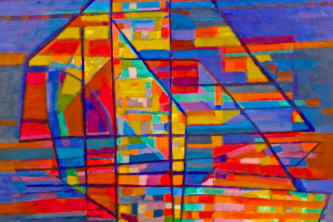
Dans le cadre de la 16e édition du colloque MSFS « Mobilités spatiales, méthodologies de collecte, d’analyse et de traitement », une table-ronde a invité quatre grands témoins (F. Dureau, P. Lannoy, J.-P. Orfeuil et T. Ramadier) à discuter de l’évolution du champ des mobilités spatiales. Issus de disciplines différentes, ces chercheurs ne partagent pas les mêmes ancrages théoriques et se demandent comment, dans leurs disciplines respectives, la mobilité est devenue un objet de recherche en tant que tel et comment elle y a été étudiée. Leurs échanges apportent un éclairage inédit sur les singularités disciplinaires et sur les évolutions plus transversales qui marquent le regard porté sur les mobilités.
Échanges présentés par Laurent Cailly et Nicolas Oppenchaim
Le Forum Vies Mobiles a soutenu un méta-projet concrétisé à l’occasion de la recherche Sortir de la dépendance à la voiture dans le périurbain et le rural. Ce projet a été à le point de départ du colloque MSFS « Mobilités spatiales, méthodologies de collecte, d’analyse et de traitement », qui s’est tenu à Tours les 8 et 9 novembre 2018. À cette occasion a été organisée la Table ronde retranscrite ici, dont la seconde partie est disponible : Dialogue sur la mobilité entre F. Dureau, P. Lannoy, J.-P. Orfeuil et T. Ramadier. 2 : Une perspective plurisdisciplinaire
Nicolas Oppenchaim : Nous avons souhaité organiser une table ronde avec quatre grands témoins susceptibles d’avoir le recul nécessaire pour documenter la genèse et les évolutions du champ de recherche sur la mobilité en France et dans les pays francophones, ainsi que les défis qui se posent actuellement aux chercheurs. Ces quatre grands témoins sont issus de disciplines différentes et ne partagent pas nécessairement les mêmes ancrages théoriques. Nous allons commencer par un regard rétrospectif sur le champ de recherche sur la mobilité, en demandant à ces chercheurs comment, dans leurs disciplines respectives, la mobilité est devenue un objet de recherche en tant que tel et comment elle y a été étudiée.
Pierre Lannoy : Pour commencer, je voudrais vous dire quelques mots sur l’histoire de la notion de mobilité en sociologie. Pour illustrer cette histoire, j’ai choisi un objet qui est le numéro 118 des Cahiers internationaux de sociologie, intitulé « Mobilité et modernité », paru en 2005. Je l’ai choisi parce qu’il est paru à un moment exceptionnel dans la discipline sociologique, pour trois raisons. D’abord, concernant la date : on est en 2005 et c’est la première fois, à ma connaissance, qu’une revue généraliste de la discipline sociologique consacre un numéro à la mobilité, entendue autrement que comme mobilité sociale, au moment même où parait une série d’autres ouvrages sur le thème. Donc on a là une sorte de momentum de l’émergence de la question des mobilités spatiales dans le champ de la sociologie, qui correspond à ce que les Anglo-Saxons vont qualifier plus tard de mobility turn. La deuxième raison pour laquelle j’ai choisi ce numéro, c’est qu’il propose une rencontre, ou en tout cas une mise en présence de trois courants, de trois manières de se rapporter à la question des mobilités chez les sociologues. Il y a deux positions extrêmes, qui se situent aux deux pôles d’un continuum : la première est de dire : « à cause des mobilités, tout est à refaire en sociologie, on entre dans un nouveau monde, et tout est à refaire ». L’autre pôle est de dire : « Rien de neuf sous le soleil, rien de nouveau pour les sociologues, malgré le fait qu’émergent les mobilités ». Puis, il y aura un troisième pôle intermédiaire sur lequel je vais revenir.
Le premier pôle, représenté dans ce numéro par la position de John Urry, est de dire : « Les mobilités ont changé le monde, donc les sociologues doivent aussi changer leur registre conceptuel ». Pour lui, il faut abandonner l’idée de société et de stabilité des groupes et des nations en particulier, alors que toute la sociologie depuis Durkheim et Weber s’est bâtie sur cette idée d’ensembles sociaux stables et notamment sur l’idée des États-nations. Donc pour Urry, il faudrait reconstruire des méthodes et des concepts pour penser un monde qui est un monde mobile. Ça c’est la thèse centrale. On a fait une sociologie classique dans laquelle on s’est intéressé à des mobilités dans des ensembles stables. C’est la notion de mobilité sociale : on observe des mouvements dans un espace stable qui est celui des positions professionnelles par exemple, ou des classes sociales. Or, aujourd’hui, c’est l’inverse : on doit penser comment s’opèrent des stabilisations qui peuvent prendre par exemple la forme d’identités, de solidarité, etc. dans un monde mobile. C’est une inversion de perspectives.
L’autre position, représentée dans ce numéro par l’article d’Alain Bourdin, c’est « Rien de neuf sous le soleil ». C’est l’idée en fait que la sociologie serait née avec la modernité, et la modernité contient en son sein les manifestations de la mobilité. L’individualisation des comportements par exemple, l’individuation des modes de vie est inscrite au cœur même de la modernité. Elle prend certes des nouvelles formes, mais ça fait partie même de la modernité ; de même pour l’urbanisation, la démocratisation, etc. ce sont des éléments centraux de la modernité. Certes, il y a des inflexions contemporaines, mais ça ne change pas du tout le programme de la sociologie. C’est le sens du titre de l’article de Bourdin : « La mobilité et le programme de la sociologie ». D’ailleurs, Bourdin termine son article en disant « surtout n’allons pas vers une sociologie des mobilités », en termes de spécialité disciplinaire. En fait, si on regarde les mobilités, on touche aux grandes questions qui sont celles de la sociologie, qui est une fille de la modernité. Ces deux positions sont tout-à-fait opposées de ce point de vue-là : la première appelle à reformuler autrement ces questions, la seconde appelle à les approfondir.
Et puis, on a aussi une série d’articles, je pense à la position des fondateurs du groupe MSFS 1, qui est de dire : « certes, une série de tendances sont liées à la modernité, mais aujourd’hui, les mobilités spatiales, par leur ampleur et par la diversification de leurs modalités, appellent à renouveler certains outils d’enquête, certains concepts, et appellent à réarticuler et ré-instruire les questions centrales de la discipline à partir de l’étude des mobilités contemporaines ». Dans ce cadre, on va avoir des propositions comme la notion de « motilité » par Vincent Kaufmann qui est en fait une relecture de la question des ressources ou du capital, selon le vocabulaire qu’on utilise. Autre exemple, la proposition de Jean Ollivro sur les classes mobiles (2005) qui est aussi une relecture de la question des classes. On peut penser à l’ouvrage récent d’Éric Le Breton sur Mobilité et société dispersée (2016), cette relecture de thèmes classiques, où on voit bien que ce qui est en jeu est la ré-articulation de questions classiques de la sociologie, réalimentées par la question des mobilités. On a donc trois positions encore présentes aujourd’hui et qui distinguent notamment les approches anglo-saxonnes et francophones. Il me semble que les approches francophones relèvent plus des deuxième et troisième positions, c’est-à-dire ré-instruire des questions fondatrices de la sociologie, alors que les approches anglophones appellent à quelque chose de complètement nouveau.
Et puis la dernière raison pour laquelle ce numéro est important, c’est qu’il est le signe de la résurgence d’un traitement des mobilités spatiales qui avait déjà eu lieu dans les années 1920-1930 autour des travaux de l’École de Chicago, qui s’était beaucoup intéressée aux mobilités non pour elles-mêmes, mais pour saisir le changement social. Ce changement social était très visible dans les grandes métropoles américaines à l’époque, notamment à Chicago, et un des éléments centraux de ces changements, c’était les mobilités. À la fois les migrations internationales, avec toutes les communautés qui arrivaient à Chicago ; les migrations internes aux États-Unis, par exemple les Afro-Américains venant du sud qui montent dans les villes industrielles du nord ; et puis les mobilités quotidiennes. Les sociologues de Chicago sont les témoins de l’avènement du téléphone et de l’automobile par exemple, qui sont utilisés au quotidien, et donc ils voient ces changements. Ils s’intéressent à ces mobilités spatiales en tant qu’elles s’inscrivent dans des changements sociaux, urbanistiques, etc. Donc, au début des années 2000, il y a une résurgence de l’intérêt des sociologues pour les mobilités quotidiennes, intérêt qui avait été mis sous le boisseau pendant près d’un demi-siècle puisqu’une série de sociologues, notamment le sociologue russe devenu Américain, Pitirim Sorokin, qui dans son livre publié en 1927, Social Mobility, « Mobilité Sociale », écrivait que « les mobilités spatiales, qu’elles soient résidentielle ou quotidienne, sont des épiphénomènes, sont des phénomènes secondaires, qui ont leurs racines dans des processus plus fondamentaux, notamment la question de la mobilité sociale, une situation et des déplacements dans un espace qui n’est pas d’abord géographique et matériel, mais qui est un espace social ». Et donc la mobilité spatiale a été mise sous le boisseau en sociologie : si vous prenez par exemple un ouvrage des années 1970, Les Dix Grandes Notions de la sociologie, vous y trouvez la notion de mobilité, mais il s’agit de la mobilité sociale. Pas une ligne sur la mobilité spatiale : les mobilités quotidiennes et spatiales ont été prises en charge par d’autres disciplines, que ce soit la géographie ou l’ingénierie du trafic et des transports. Cet intérêt pour les mobilités spatiales a été remis à l’avant-plan de la sociologie en France par exemple par Isaac Joseph ou Christian Topalov, qui ont redécouvert l’École de Chicago, Jean Rémy en Belgique avec l’École de Louvain, ou encore Michel Bassand en Suisse ou Vincent Kaufmann pour la suite. N’oublions pas aussi un livre qu’on cite peu mais qui a eu, je pense, beaucoup d’influence sur une ré-interrogation sur les mobilités, c’est le livre de Marc Augé, Non-Lieu, paru en 1992, qui a suscité beaucoup de débats – sans doute plus encore dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone –, mais qui est un des premiers à remettre d’une certaine façon à l’agenda de la discipline la question à la fois des mobilités et des lieux.
Françoise Dureau : De mon côté, je suis géographe et démographe, donc ce que je vais dire est marqué par le fait de relever de ces deux disciplines. L’autre chose que je tiens à préciser, c’est que je n’étudie pas les mobilités spatiales pour elles-mêmes. Elles m’intéressent pour comprendre certaines dynamiques territoriales urbaines.
Je suis donc marquée par la démographie, et la démographie regarde le mode de rattachement des hommes aux lieux à travers une notion particulière : la résidence, c’est-à-dire là où la personne a coutume d’habiter. Cela m’a aiguillée au départ vers l’analyse des migrations qui sont des changements de résidence. Puis sur des questionnements de mobilité résidentielle intra-urbaine, et je me suis aperçue petit à petit que ça ne suffisait pas, et donc qu’il fallait intégrer une dimension qui relevait des mobilités quotidiennes. Sur ce point, je pense qu’il est important de préciser sur quel type de mobilité on travaille, parce que les cloisonnements dans le champ d’étude de la mobilité spatiale en sous-champ spécialisés sont liés au fait que chacun de ces champs s’est développé sur une forme de mobilité spatiale. On a les spécialistes de la migration internationale, ceux de la migration interne, ceux de la mobilité résidentielle intra-urbaine et ceux de la mobilité quotidienne. Personne ne s’affiche en tant que spécialiste, chacun va vous parler de la mobilité en général alors qu’il travaille 9 fois sur 10 sur une forme de mobilité spécifique. En démographie on ne s’intéressait pas à la mobilité quotidienne parce qu’il n’y avait pas de changement de résidence associé à ce type de déplacement ; donc la mobilité quotidienne a été exclue pendant très longtemps du champ de la démographie. D’ailleurs, je rappelle que si ça peut paraître une évidence que les démographes travaillent sur la migration, cet objet a été vu pendant très longtemps uniquement comme un phénomène perturbateur des phénomènes jugés purement démographiques que sont la fécondité, la mortalité, la nuptialité. Et au départ, dans l’enseignement que j’ai reçu à l’IDUP 2 dans les années 1970, c’était vraiment ça ! Si on regarde des manuels d’analyse démographique de l’époque, la migration n’était qu’un phénomène perturbateur des « vrais » phénomènes démographiques. Il a fallu des pionniers à l’INED comme Daniel Courgeau ou Philippe Collomb pour faire admettre que la migration était bien un objet de recherche légitime pour les démographes.
Cette segmentation du champ d’étude de la mobilité spatiale, par forme de mobilité, est il me semble entretenue aussi par une dimension institutionnelle. Il y a des institutions spécialisées de recherche, des EPST (Établissements publics à caractère scientifique et technologique), qui sont spécialisés chacun sur un champ de recherche. L’INRETS, devenue IFSTTAR, sur le transport, la mobilité quotidienne ; l’INED, sur la mobilité résidentielle, les migrations internes ; et un laboratoire comme Migrinter, sur les migrations internationales. Ce découpage-là joue donc un rôle, ainsi que les modes de financement de la recherche. Finalement, quarante ans après que des auteurs comme Daniel Courgeau (1988) ont dit et ré-insisté sur le continuum des formes de mobilité et la nécessité d’une approche globale de la mobilité spatiale, en termes de systèmes de mobilité des individus et de leur famille, cette segmentation est dans les faits toujours effective. Pourtant, dans ce que proposaient Daniel Courgeau, Wilbur Zelinsky (1971) ou d’autres, on voit que ce qui est en cause, ce sont les systèmes de relations des individus et de leur famille aux différents lieux qu’ils pratiquent. Donc finalement, ce n’était pas seulement l’objet des déplacements qui était au centre de l’analyse, mais la pratique de différents lieux à différentes échelles spatiales et temporelles, et des effets sociaux et territoriaux de cette pratique-là ; je crois que c’est ça le réel enjeu. Mais pour le travailler correctement, comme l’ont écrit ces auteurs et beaucoup d’autres après, je crois que la seule manière est de travailler de manière globale sur l’ensemble des formes de mobilité.
Les effets de ces segmentations se traduisent dans des divergences profondes en termes de concepts et de méthodes, sans que cela ne soit jamais explicite. Je le rappelle, chacun parle de mobilité en général alors qu’en fait, il ne se réfère le plus souvent qu’à une seule forme de mobilité. Je ne crois pas qu’il y ait de réel débat ni d’efforts pour avancer dans une perspective de théorisation globale de la mobilité spatiale. Ces segmentations se traduisent aussi par une méconnaissance quasi-totale de ce qui est produit en dehors de sa propre discipline, de son champ d’étude de la mobilité spatiale. Dans plusieurs communications de ce colloque, j’ai remarqué des références bibliographiques sur ce qui s’appelle le champ de recherche des mobility biographies. Démarche tout à fait intéressante qui correspond à l’introduction d’une approche longitudinale dans l’étude de la mobilité quotidienne. Mais ce qui est regrettable, c’est de voir que dans les références et dans le contenu des articles, l’analyse quantitative des biographies développée en démographie, qui est quand même aussi bien publiée en anglais, qu’en français et en espagnol, est totalement ignorée. On voit aussi des travaux récents menés par des spécialistes de la mobilité quotidienne, par exemple sur les liens entre mobilité quotidienne et mobilité résidentielle, qui ne prennent pas en considération toutes les connaissances produites depuis plusieurs décennies grâce au développement d’une approche biographique de la mobilité résidentielle, mouvement dans lequel les francophones ont eu une place importante, notamment les chercheurs de l’INED. Les segmentations ont donc des effets particulièrement nocifs même si chacun reste dans son sous-champ d’étude spécialisée.
Mais il existe des évolutions qui traversent le champ d’étude de la mobilité résidentielle et de la migration comme les autres champs d’étude des sciences sociales. Pour moi, l’inflexion majeure en France dans ce champ d’étude, c’est l’introduction de l’approche biographique dans les années 1980. Cette fameuse enquête, qui s’appelle l’enquête 3B [« Triple Biographie »] menée par l’INED en 1981, a conduit à des avancées importantes dans la connaissance de la mobilité résidentielle et de ses relations avec la mobilité professionnelle et les événements familiaux. Il y a eu d’autres évolutions importantes dans ce champ. L’abandon d’une approche en termes de simple rationalité économique est quelque chose qui a marqué ces dernières décennies. De même, le retour en force de l’École de Chicago après une période centrée autour d’une lecture structuraliste. Il y aussi eu un changement de terminologie quand on passe de migration à mobilité, comme le démontre très bien un article de Jacques Brun, dans un numéro de 1993 des Annales de la recherche urbaine consacré aux mobilités 3. Pour moi, c’est un article fondateur qui retrace l’évolution des questions de migration et de mobilité résidentielle sur trente ans, dans le champ de la sociologie et de la géographie françaises ; il retrace les évolutions qui ont marqué tout ce champ d’étude. On observe dans les dernières décennies une remise en cause du critère de résidence considérée comme unique et permanente et une reconnaissance du caractère multiple de la localisation de l’individu ; d’où la prise en considération des pratiques résidentielles complexes, et l’étude des formes de mobilité circulaire ou temporaire qui sous-tendent ces systèmes résidentiels complexes. Autre évolution : le passage, de plus en plus fréquent, d’une unité d’analyse individuelle à une unité collective (la famille, l’entourage, la communauté, etc.). Les mobilités spatiales des individus sont alors considérées comme des composantes de stratégies de reproduction sociale et économique des familles. Et la dernière des évolutions qui me paraît aussi marquer récemment l’étude de la mobilité spatiale, c’est une certaine revalorisation ou reconnaissance de l’immobilité. Et ce après des décennies de valorisation de la mobilité, avec l’idée sous-jacente que le mobile ou le migrant a besoin de certains capitaux pour réaliser sa mobilité, son déplacement. C’est ce qu’on appelle la sélectivité de la migration, un modèle de base en démographie. En fait, on s’aperçoit petit à petit que si on prend en considération les changements des environnements dans lesquels vivent les individus, parfois, c’est rester qui réclame des ressources, des capitaux et des compétences, et non pas partir. Cette lecture amène à reconsidérer l’immobilité spatiale et la valorisation antérieure de la mobilité. Sinon, il y a une permanence que je tiens à soulever, qui est assez frappante quand on cherche à travailler à la fois sur la mobilité résidentielle et sur la mobilité quotidienne en France : on passe de séminaires totalement féminins, ceux qui sont sur la mobilité résidentielle où il n’y a que des chercheuses, à ceux centrés sur la mobilité quotidienne… et là on retombe dans le schéma habituel, où c’est le monde des transports et des petites voitures, donc des hommes [rires dans la salle]. C’est quelque chose qui est assez permanent…
Thierry Ramadier : Je ne parlerai pas des segmentations disciplinaires, mais plutôt des différentes étapes qui me semblent être intervenues pour arriver à un fait marquant : le fait qu’on parle de « la » mobilité de manière générique plutôt que de parler « des » mobilités. Avec deux autres collègues, Simon Borja et Guillaume Courty, nous nous sommes posé la question suivante : comment cette notion de mobilité est apparue ? Nous avons essayé d’y répondre dans un article à partir duquel je vais organiser mon propos 4. Nous y retracions l’évolution de la question des mobilités dans trois champs : le champ artistique, le champ politique et le champ scientifique. Alors, ce que je vais faire, c’est vous présenter trois étapes qui me semblent importantes, et du point de vue de ma discipline je vais ajouter ce qui se passait en psychologie à chacune de ces étapes. Parce que la psychologie est, pour le coup, très peu légitime, souvent invisible sur la question des mobilités, et c’est aussi la raison pour laquelle je suis content de pouvoir en parler, parce qu’il rare que la psychologie soit invitée à une table ronde comme celle-là.
Je vais associer une notion à chacune de ces étapes. La première étape tourne autour de celle de flux. C’est à partir des années 1930 qu’on commence à penser les déplacements géographiques, ce qu’on appelle maintenant les mobilités géographiques, mais à partir d’une approche ingénieuriale, notamment aux États-Unis : les ingénieurs du trafic développent la notion de flux avec l’idée de penser le mouvement pour le faciliter. Donc ici, « déplacement » est vraiment synonyme de « transport », surtout centré sur les modes mécanisés. D’ailleurs, les grandes enquêtes sur les flux de déplacement qui vont se mettre en place seront essentiellement centrées sur ces modes – on ne va pas parler de déplacements à pied par exemple. L’idée, c’est d’optimiser les déplacements par la technique. Le déplacement est perçu ici comme un besoin, même si aujourd’hui, avec du recul, des travaux comme ceux de Guillaume Courty, sur le code de la route, ou de Pierre Lannoy montrent que cette optimisation technique est aussi une construction politique. C’est l’invention du déplacement rationnel. C’est l’idée de fluidité du trafic qui est au centre des préoccupations. Alors, qu’est-ce qui se passe du côté de la psychologie durant cette période qui s’étend des années 1930 jusqu’au milieu des années 1970 et où la notion de flux prédomine ? Il y a la création progressive d’une branche de la psychologie qui s’appelle la psychologie environnementale, avec le développement d’une méthode d’analyse : la cartographie comportementale. Par exemple, Harold Proshansky, dans les années 1970, regarde comment se déplacent les patients dans un hôpital psychiatrique ; on a une approche à l’échelle de l’individu. Je dirais que ça, ce sont les approches naissantes sur cette question des mobilités ; pour vous donner un autre exemple, Paul-Henry Chombart de Lauwe, qui n’est pas psychologue, avait fait la carte comportementale d’une étudiante du XVIe arrondissement de Paris, dont il avait cartographié tous les lieux de déplacement ; voilà, c’est ça la cartographie comportementale. Alors, il y a une publication étonnante à cette période : celle de Serge Moscovici, qui a beaucoup travaillé sur les représentations sociales en psychologie sociale, et qui publie dans une revue de sociologie un article qui a pour titre « La résistance à la mobilité géographique dans les expériences de reconversion 5 ». « Étonnant », pourquoi ? Publié en 1959, il a une approche finalement assez critique de cette notion de mobilité ou d’immobilité comme trait de personnalité, des gens qui sont plus casaniers ou moins casaniers, et il met en lien la mobilité professionnelle avec les mobilités géographiques, ce qui est assez innovant à cette époque-là.
La seconde période s’étend du milieu des années 1970 jusqu’au milieu des années 1990. Pourquoi le milieu des années 1970 ? Parce que Cullen et Godson (1975) publient un article sur la mobilité comme demande dérivée de l’activité 6. Nous sommes là dans une période où c’est la notion de déplacement qui va prendre le dessus. La mobilité est envisagée comme un besoin individuel. Nous passons de la régulation des flux à une régulation des individus, et donc nous travaillons à l’échelle de l’individu. Nous sommes dans une approche désagrégée – les mobilités sont une somme de comportements individuels – qui devient possible avec l’émergence des capacités de calcul, et une formalisation mathématique toujours plus importante centrée sur une approche rationnelle du déplacement, avec les concepts d’utilité, de choix rationnels, etc. C’est donc une approche qui reste ingénieuriale, mais l’économie est aussi fortement invitée à y participer, et l’interdisciplinarité devient vraiment importante à ce moment-là. Une des problématiques les plus importantes de ce moment, c’est celle des leviers de changements comportementaux, notamment en termes de modes de déplacement. Le changement modal. On est dans une période où la principale question est : comment faire pour passer de l’automobile aux transports en commun ? Quelle est la place de la psychologie dans cette période-là ? Il y a deux grandes tendances. D’abord celle où elle est invitée pour travailler sur les dimensions subjectives de la rationalité. Il s’agit de compléter cette dimension rationnelle par des subjectivités, typiquement c’est : « quelles sont les distorsions en termes de distance qui font qu’on va plutôt privilégier tel ou tel lieu de destination ? », « quelles sont les distorsions en termes de temps, ou en termes de coût, qui interviennent dans la manière dont les personnes font leurs choix des lieux ou des modes utilisés ? », etc. Dans cette optique, des psychologues comme Thomas Golob et Jordan Louviere interviennent à ce moment-là. Et puis il y a aussi une formalisation psychologique autour de l’organisation des déplacements quotidiens, c’est-à-dire une analyse de la façon dont se structurent les décisions en termes de déplacement. Je pense notamment aux travaux de Tommy Gärling, en Suède, qui rejoignent aussi tout un pan de la recherche en psychologie qui travaille sur le lien entre représentations et déplacements, sur les way-findings, sur la question de l’orientation, qui est donc un domaine dans lequel interviennent les psychologues. Il y a bien sûr toujours des petites choses qui passent à la trappe. Je pense ici, à cette période, à un travail de Françoise Askevis-Leherpeux en 1985 7 ; son côté novateur, c’est qu’elle va proposer du point de vue de la psychologie des liens entre la mobilité quotidienne et la mobilité résidentielle. Elle va regarder ce qui se passe en termes de déplacements quotidiens avant et après un déménagement de Paris vers la banlieue, avec une approche quasi-expérimentale. Il me semble que c’est avant l’heure un travail sur les liens entre mobilités quotidienne et résidentielle.
La dernière période est celle que l’on connaît, celle des mobilités. Il me semble que c’est à partir du milieu des années 1990 qu’elle se construit. Et ici, l’idée est de penser la facilité à se mouvoir, et non plus, comme dans la première période, de comprendre le mouvement pour le faciliter. Ça ne veut pas dire que les étapes sont complètement étanches les unes des autres, c’est un empilement : la question des flux est toujours très présente dans la manière de penser les mobilités. Une étape n’en évince pas une autre. Dans cette période, l’idée centrale est que la mobilité est plus qu’un déplacement. Il y a une sociologisation de ces recherches, et ce n’est pas par hasard qu’on utilise le terme de mobilité, puisque dans les sciences sociales, le mot « mobilité » apparaît avant tout en sociologie. Pierre Lannoy nous le rappelle, ce n’est pas quelque chose de nouveau, avec la mobilité sociale. La mobilité géographique va se sociologiser, mais surtout à l’échelle de l’individu, paradoxalement. L’idée est de travailler cette fois-ci sur la notion de compétences à la mobilité. Penser la facilité à se mouvoir, c’est saisir les compétences nécessaires pour se déplacer, et donc chercher à améliorer les compétences individuelles pour régler des inégalités en termes de mobilité. Du coup, on tombe sur une notion, qui d’ailleurs est dans l’acronyme « MSFS », qui est celle de fluidité. Mais nous ne sommes plus dans la fluidité du trafic, nous sommes dans la fluidité sociale. Comme ce que nous disait tout à l’heure Pierre Lannoy sur les différents courants en sociologie : sommes-nous dans une société déstructurée socialement, complètement fluide et régulée par les mobilités, ou bien est-ce que les mobilités géographiques viennent s’ajouter aux structures sociales ? Cette question-là devient centrale, ainsi que l’idée de fluidité sociale. Finalement, le point majeur ici est que la mobilité est assez souvent pensée comme un passeport pour l’ascenseur social. Et cela a des répercussions importantes sur les manières de penser les inégalités sociales associées aux mobilités. L’idée est qu’elles restent un besoin, comme pour la phase des déplacements. Les mobilités restent un besoin et il faut les favoriser pour qu’il y ait une certaine égalité sociale. Il me semble alors que nous sommes dans une période où les rapports de pouvoir qui s’inscrivent dans les mobilités ne sont pas si clairs que ça, et il me semble que c’est sur ces aspects-là que l’on devrait réfléchir. Du côté de la psychologie, que se passe-t-il ? En fait, c’est un renouvellement de la cartographie comportementale. Je pense par exemple aux travaux de Sandrine Depeau 8, où la cartographie comportementale est analysée au regard de prescriptions sociales (celle des parents vis-à-vis des enfants) et de normes sociales. Voilà ce qui me semble pouvoir être une sorte de sociohistoire des mobilités dans laquelle s’inscrit également la psychologie, même si elle est un peu moins visible.
Jean-Pierre Orfeuil : Comme je me doutais bien que j’étais le doyen de cette table ronde, je vais tâcher de remonter un petit peu dans le temps et de vous présenter quelques personnes que je considère comme des grands noms, en tout cas des gens qui ont pu influencer le champ – ils sont tous anglophones –, puis d’essayer de voir dans quel contexte ils ont travaillé, quelles étaient leur méthode et leur vision de la mobilité.
Le premier, avant l’apparition du terme de « mobilité » dans le domaine des déplacements quotidiens, c’est Alan Voorhes, avec la construction des modèles gravitaires. À ce moment, cela correspond à une demande sociale : les États-Unis se mettent à faire un programme d’autoroutes urbaines, et assez paradoxalement, les gens se disent « Attendez, faut pas en faire trop » ; ils arrivent à trouver un « matheux » qui va faire ce que l’on appelle les modèles gravitaires, dans le but de séparer les segments de programme qui correspondent à la demande la plus forte et ceux qui paraissent les moins utiles. Il va piquer un peu dans la géographie, un tout petit peu dans l’économie (notamment ce qui a été établi sur le marché du travail, c’est-à-dire la valeur du temps et la notion de coût généralisé). C’est un grand bricoleur. En termes de vision, l’idée, c’est que la ville est complètement prévisible, on sait où seront implantés les gens et les activités dans 20-30 ans. On en en déduit ce que seront les flux de déplacements, et donc les infrastructures nécessaires. Les conséquences de son travail seront le développement de nombreuses modélisations de trafic. Ce sera aussi la naissance des enquêtes de déplacement (dites enquêtes ménage parce qu’on interroge toutes les personnes du ménage), qui seront utilisées par la suite à des fins non planificatrices, mais à des pures fins de connaissance de la mobilité. C’était le point de départ avant la mobilité.
À la fin des années 1970, le terme de « mobilité » arrive dans le champ des déplacements quotidiens. Avant, on parlait de migrations alternantes, de pendularité, c’est-à-dire de phénomènes vus collectivement. Parler de mobilité, ça veut dire individuer les choses, ça veut dire éventuellement qu’il y a des projets derrière ; il y a une construction plus personnelle : on est dans le domaine de l’individuation, et comme souvent, il s’agit peut-être de hasards de l’histoire, mais il se trouve que les capacités de traitement informatique grandissent, et donc qu’on peut aussi travailler dessus, parce que travailler sur des individus, c’est plus lourd que travailler sur des flux. À cette période, toute une série de gens se lèvent pour dire : « Attendez, on n’est pas des atomes, on n’est pas des machins comme ça qui se mettent dans des flux, on est des gens, donc il faut mieux comprendre les pratiques différenciées des uns et des autres, selon que ce sont des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, etc. ». Les chercheurs qui vont commencer à s’imposer dans ce domaine, ce sera ceux qui fabriqueront les modèles dits « désagrégés », de choix de destination, de modes, etc. Ils ont des outils bien rôdés (les modèles logit ou probit), qui modèlisent la probabilité de choisir telle ou telle option dans un ensemble de choix possibles. En gros ce sont des économètres, et comme vous le savez sans doute, les économètres pensent avoir la seule science sociale véritable, donc a priori ce n’est pas d’eux qu’on va attendre une grande ouverture du champ. En revanche, ce qui est très amusant, c’est que leur méthode va de temps en temps être appropriée par des sociologues. Il faut quand même rappeler que quelqu’un comme François de Singly fait sa thèse avec des modèles désagrégés pour savoir avec qui vous allez vous marier, combien d’enfants vous allez avoir, enfin des choses dont on n’imaginait pas qu’elles soient modélisables.
Arrive ensuite, venant cette fois de Scandinavie, un apport important de quelqu’un qui s’appelle Torsten Hägerstrand et qui va développer ce qu’il appelle la géographie du temps. Il s’agit en gros de dire : « voilà, les gens ont ceci ou cela à faire, à tel point du territoire et à tel moment, est-ce qu’ils auront beaucoup de facilités à le faire ? est-ce qu’il y a des inégalités ? est-ce que quelqu’un qui a des enfants à emmener à la crèche le matin a plus de contraintes pour organiser sa journée après ? » Ce n’est pas quelque chose qui pourra donner lieu à des modèles standards, mais un outil de réflexion tout-à-fait important. Je dirais que ce n’est évidemment pas aux géographes suédois que l’on doit l’ouverture des commerces de centre-ville entre midi et deux heures, mais enfin bon, il y a quand même eu une époque où, en France, les commerçants fermaient entre midi et deux heures pour aller manger, donc Hägerstrand nous dit que c’est quand même là qu’il y a un peu de clients : ceux qui travaillent au centre et ont leur pause de midi. Il faut sortir de la vision où les gens ne sont qu’à domicile : nous faisons des déplacements « secondaires » insérés dans des boucles. L’organisation urbaine de base des urbanistes des années 1950-1960, partait du principe que les gens sont à domicile et que c’est ce qu’il y a autour qui doit leur faciliter la vie quotidienne. Ce qu’on doit aussi à Hägerstrand, et ça me paraît important, c’est l’idée qu’une mobilité réalisée et une mobilité-projet sont deux choses différentes. Il y a une demande latente qui n’est pas nécessairement ce qu’on observe : tout le monde n’arrive pas à réaliser son projet ou ses besoins. On retrouve cette question des compétences, à travers par exemple l’accès ou non à l’automobile, ou en tout cas au moyen de déplacement le plus rapide. Il y a des gens qui n’ont pas cet accès-là, et qui auront moins de compétences que les autres, un thème qu’on retrouve aujourd’hui dans tous les domaines.
Quatrième chercheur, Phil Goodwin, qui intervient au moment des années Thatcher. Les Anglais n’en ont pas un très bon souvenir, mais pour la recherche, ce sont des années extraordinaires parce que tout peut bouger très vite : ainsi, le tarif du métro est d’abord divisé par deux puis multiplié par deux au retour d’un maire travailliste à Londres. C’est un vrai laboratoire d’expériences. Goodwin nous dit en gros : « faire une image à trente ans de ce que sera, ou devrait être, la mobilité, je m’en fiche un peu. Ce qui m’intéresse, ce sont les processus de changement. » Ce qui est intéressant, c’est de faire un peu le film des difficultés à changer, de vaincre les rationalités d’habitude. Tout ce qui tourne autour de l’inertie, de la capacité de changement, etc., va être quelque chose d’important. Ce sont là des choses qui sont du domaine de la psychologie et de la sociologie, autant que de l’économie.
Enfin, le dernier dont je voudrais parler et qui à mon avis est celui qui est le plus porteur d’enseignements qu’il n’a pas nécessairement formulés lui-même, puisqu’il est mort d’une crise cardiaque dans un colloque en 1983, c’est Yacov Zahavi. Dans un certain nombre d’enquêtes menées un peu partout, et notamment des enquêtes avant/après la mise en place de systèmes de transports censés faire gagner du temps, il s’aperçoit qu’on passe toujours le même temps dans les transports avant/après, mais que l’espace s’est transformé. Donc la conjecture de Zahavi, c’est de dire qu’on se déplace dans des enveloppes à peu près constantes de budget-temps et de budget monétaire. Cela signifie que l’on passe une heure à une heure et demi par jour à se déplacer, et qu’on y consacre 10-12 % de nos ressources globalement, aussi bien dans l’achat des véhicules que dans l’achat des titres de transport, etc. Cette conjecture de Zahavi a été mise en doute, discutée (ça c’est normal, c’est une activité scientifique normale de discuter). C’est une loi très forte, qui a été discutée par des ingénieurs, des urbanistes, des psycho-sociologues, des économistes. Alors les économistes, comme d’habitude, ont dit « non, non, ça ne peut pas être, puisque ce n’est pas conforme aux lois de l’économie ». En reformulant les choses, l’idée de Zahavi est de dire : « Finalement, être urbain ou être citadin du monde d’aujourd’hui, c’est essayer de maximiser les opportunités qu’offre l’espace et on le fait dans une enveloppe contrainte de temps et de coût. » Cela renvoie aussi à un des enjeux de la recherche, qui est de savoir si on réfléchit à des niveaux collectifs, à des niveaux individuels ou à des niveaux méso-essayant de mixer l’individuel et le collectif. La conjecture de Zahavi, à la base, c’est un peu quelque chose d’individuel, mais en même temps, bien évidemment que le résultat est collectif et qu’on est en train d’alimenter un système pour partie circulaire qui consiste à dire : « À partir du moment où on va avoir des moyens de déplacement plus rapides ou moins fatigants ou moins coûteux, là ,on a une possibilité d’extension des espaces. ». On passe donc d’un phénomène individué à un phénomène plus collectif. On aura ainsi beaucoup d’écrits sur l’étalement urbain (ou un maillage de plus en plus lâche de l’espace par les activités), comme produit de la mobilité facilitée, mais aussi sur la mobilité comme facteur, enfin comme aide, à la ségrégation sociale. À partir du moment, et ça on l’a vu dès le XIXe siècle, où vous mettez un ascenseur dans les immeubles, vous ne réservez plus les étages très supérieurs aux bonnes et aux pauvres. La mobilité permet donc des réorganisations de l’espace, et si la tendance est à la ségrégation, s’il y a, si j’ose dire, une demande de ségrégation, la mobilité fait partie des moyens qui la facilitent. Et je terminerai en disant qu’au fond c’est aussi un enjeu politique, au sens noble du terme. Qu’est-ce qu’on a fait depuis cinquante ans en facilitant les mobilités ? Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui en facilitant les communications ? On transfère du pouvoir des collectifs vers les individus. Aujourd’hui, vous avez des politiques publiques pour lutter contre la ségrégation, l’étalement urbain, etc., qui font suite à des tas de décennies de facilitation de la mobilité. Finalement, en facilitant la mobilité, on a facilité les phénomènes qu’on cherche à combattre aujourd’hui. Je voudrais conclure dessus, et je suis tout-à-fait d’accord avec ce que disait Françoise Dureau tout à l’heure sur la segmentation des champs : il y a peut-être une autre dimension à prendre en compte qui est ce dialogue que l’on doit toujours avoir entre l’observation individuelle et les conséquences collectives. On sait depuis longtemps que la somme d’optimums individuels n’est pas un optimum collectif, et je crois que les questions de mobilité sont là pour le montrer de façon très forte.
Askevis-Leherpeux F., « Mobilité et espace urbain : comment réduire l’ambiguïté d'une relation », L’Année psychologique, vol. 85, n°4, 1985, p. 535-548.
Augé M., Non lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Coll. La librairie du XXIème siècle, Seuil, 1992, 160 p.
Borja S., Courty G., Ramadier Th., « Trois mobilités en une seule ? », EspacesTemps.net [En ligne], Travaux, 2014 | Mis en ligne le 14 octobre 2014. https://www.espacestemps.net/articles/trois-mobilites-en-une-seule/ (consulté en mai 2020).
Brun J., « La mobilité résidentielle et les sciences sociales. Transfert de concept, questions de méthodes », Les annales de la recherche urbaine, n° 59-60, 1993, p. 3-14.
Cahiers internationaux de sociologie, « Mobilité et modernité », Presses universitaires de France, 2005/1, n° 118, 192 p.
Cazeneuve J., Dix grandes notions de sociologie, Coll. Essais, Points, Seuil, 256 p, 1976.
Courgeau D., Méthodes de mesure de la mobilité spatiale, Éditions del'Ined, Paris, 301 p, 1988.
Cullen, Ian et Vida Godson. 1975. « Urban Networks : The Structure of Activity Patterns », Progress in Planning, vol. 4, n° 1, p. 1-96.
Golob, Thomas, Horowitz, Avram et Wachs, Martin. 1979. « Attitude Behavior Relationship in Travel Demand Modelling » in Henscher, David et Peter Stopher (dirs.). Behavioral Travel Modelling, p. 739-757. London : Croom Helm.
Le Breton E., Mobilité et société dispersée, une approche sociologique, coll. Logiques sociales, L’Harmattan, 2016, 226 p.
Moscovisci P., « La résistance à la mobilité géographique dans les expériences de reconversion », Sociologie du travail, Paris, Seuil, n° 59, p. 24-36, 1959.
Louviere, Jordan et al. 1979. « Application of Psychological Measurement and Modeling to Behavioural Travel Demand Analysis » in Henscher, David et Peter Stopher (dirs.). Behavioral Travel Modelling, p. 55-80. London : Croom Helm.
Ollivro J., « Les classes mobiles », in L’information Géographique, 69-3, p. 28-44. Sorokin P., Social Mobility, Harper et Brothers, New York, 1927.
Zelinsky W., « The Hypothesis of Mobility Transition », Geographical Review, vol. 61, n° 2, p. 219-249, 1971.
1 Il s’agit du groupe de travail interdisciplinaire « Mobilités spatiales fluidité sociale », créé en 2002, au sein de l’AISLF.
2 Institut de démographie de Paris Panthéon Sorbonne.
3 Jacques Brun, « La mobilité résidentielle et les sciences sociales: transfert de concept et questions de méthodes », Annales de la recherche urbaine, no 59-60, 1993.
4 Borja S., Courty G., Ramadier Th., « Trois mobilités en une seule ? », EspacesTemps.net, Travaux, 2014. https://www.espacestemps.net/articles/trois-mobilites-en-une-seule/ (consulté en mai 2020).
5 Moscovisci P., « La résistance à la mobilité géographique dans les expériences de reconversion », Sociologie du travail, Paris, Seuil, n° 59, p. 24-36, 1959.
6 Cullen I. et Godson V., « Urban Networks : The Structure of Activity Patterns », Progress in Planning, vol. 4, n° 1, 1975, p. 1-96.
7 Askevis-Leherpeux F., « Mobilité et espace urbain : comment réduire l’ambiguïté d'une relation », L’Année psychologique, vol. 85, n°4, 1985, p. 535-548.
8 Voir https://perso.univ-rennes2.fr/sandrine.depeau (consulté en mai 2020).
Pour le Forum Vies Mobiles, la mobilité est entendue comme la façon dont les individus franchissent les distances pour déployer dans le temps et dans l’espace les activités qui composent leurs modes de vie. Ces pratiques de déplacements sont enchâssées dans des systèmes socio-techniques produits par des industries, des techniques de transport et de communication et des discours normatifs. Cela implique des impacts sociaux, environnementaux et spatiaux considérables, ainsi que des expériences de déplacements très diverses.
En savoir plus xMichel Bassand est un sociologue suisse né en 1938, spécialisé dans les questions urbaines. Il a été successivement professeur à l’Université de Genève et à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). On lui doit une conception théorique originale de la mobilité comme phénomène social total dont les différentes manifestations forment un système.
En savoir plus xLe déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination sans véritable origine ou destination.
En savoir plus xLa mobilité résidentielle désigne, de manière large, le changement de lieu de résidence d’un ménage à l’intérieur d’un bassin de vie.
En savoir plus xLa valeur du temps, en économie des transports, correspond à la disposition de chaque individu à payer pour gagner du temps. Elle permet d’expliquer les choix de modes de transport comme résultant d’arbitrages entre coûts financier et temporel. Elle sert également à orienter et à justifier financièrement les choix d’investissements sur la base des gains de temps permis par une nouvelle infrastructure.
En savoir plus xLes recherches sur la transition s'intéressent aux processus de modification radicale et structurelle, engagés sur le long terme, qui aboutissent à une plus grande durabilité de la production et de la consommation. Ces recherches impliquent différentes approches conceptuelles et de nombreux participants issus d'une grande variété de disciplines.
En savoir plus xAutres publications