
07 Novembre 2017
Trois fois par semaine, le vieux pont qui traverse le Riachuelo, à Buenos Aires, est saturée d’un flot constant de bus longue distance. Les passagers ont parcouru des centaines de kilomètres, ils viennent des quatre coins de l’Argentine et même des pays voisins, Paraguay, Brésil et Chili. Un vol en avion d’une heure ou deux devient, pour ceux qui ne peuvent pas payer le billet, un trajet de dix, vingt ou même trente heures de bus. Le pont annonce enfin la fin du voyage ; de l’autre côté du fleuve huileux, rempli d’ordures, un immense parking accueille les visiteurs à La Salada, le plus grand marché de vêtements bon marché d’Amérique du Sud.
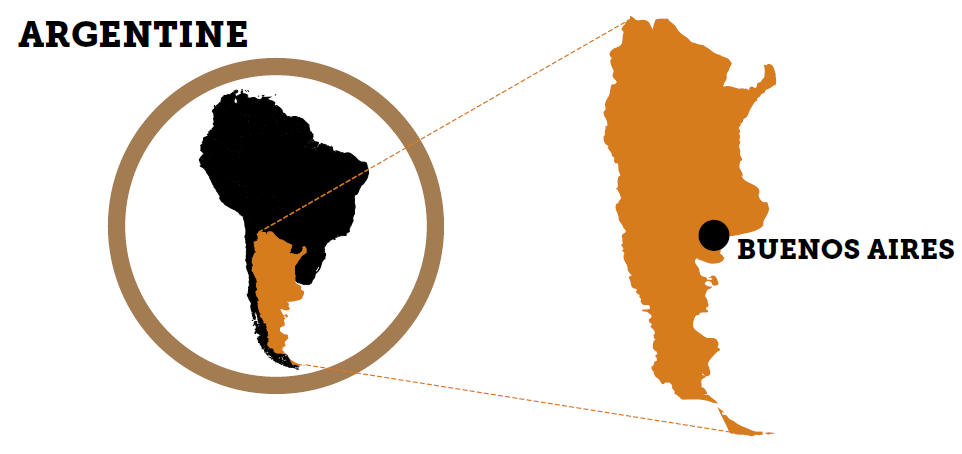
Trois fois par semaine, la circulation sur le vieux pont qui traverse le Riachuelo, à Buenos Aires, est saturée d’un flot constant de bus longue distance. Les passagers ont parcouru des centaines de kilomètres, ils viennent des quatre coins de l’Argentine et même des pays voisins, Paraguay, Brésil et Chili. Un vol en avion d’une heure ou deux devient, pour ceux qui ne peuvent pas payer le billet, un trajet de dix, vingt ou même trente heures de bus. Le pont annonce enfin la fin du voyage ; de l’autre côté du fleuve huileux, rempli d’ordures, un immense parking accueille les visiteurs à La Salada, le plus grand marché de vêtements bon marché d’Amérique du Sud.

© Photographie de Sarah Pabst
Les passagers ne sont pas des consommateurs ordinaires. Il s’agit très majoritairement de grossiste, qui viennent acheter des sacs de 50 kilos de vêtements pour les revendre sur de plus petits marchés dans leur ville ou village d’origine. Le choix est ahurissant, avec près de 8 000 stands presque entièrement dédiés aux habits – jeans, vestes, chaussures, chaussettes, tabliers, serviettes, tenues de sport, de travail ou de soirée, pour les hommes, les femmes et les enfants. Près de la moitié sont contrefaits, affichant des logos célèbres comme Nike, Adidas, Puma et Disney. Tous sont fabriqués dans des ateliers de misère.
Les mots « ateliers de misère » évoquent généralement d’immenses usines, où des travailleurs exploités et précaires triment des heures durant dans des conditions difficiles pour un maigre salaire, sans aucune prise en charge. La rencontre avec Juan, migrant bolivien, et de nombreux autres travailleurs de La Salada, confirme certaines de ces idées : journées de seize heures, six jours par semaine, utilisation de machines et produits chimiques dangereux, exploitation effrénée par des trafiquants d’êtres humains. Ces derniers font venir à Buenos Aires des Boliviens qui espèrent une vie meilleure mais se voient au contraire confisquer leur passeport jusqu’à ce qu’ils aient fait assez d’heures dans l’atelier des trafiquants pour rembourser leur dette. Parfois, l’exploitation se fait en famille – Juan a commencé par travailler dans l’atelier de son oncle, mais celui-ci a fini par le mettre dehors avec sa famille et voler plusieurs rouleaux de tissu. Aujourd’hui à la tête de son propre atelier dans la maison louée par la famille dans le dangereux quartier de La Salada, Juan se décrit comme un esclave du marché.

© Photographie de Sarah Pabst
Tout cela était choquant, mais pas vraiment étonnant. Toutefois, ce à quoi nous ne nous attendions absolument pas, en menant une recherche sur les ateliers clandestins, était l’incroyable énergie qui imprégnait La Salada. Ce qui, pour nous, était le premier maillon d’une chaîne d’approvisionnement nationale basée sur l’exploitation, représentait pour des milliers d’entrepreneurs, de marchands et d’acheteurs le « centre du monde ». En interrogeant et en photographiant des travailleurs de La Salada comme Juan, nous avons vu et entendu les échos répétés d’une positivité généralisée. Ce que nous ne pouvions pas voir, c’était sa source.
C’est un autre entretien, avec Ignacio cette fois, qui a résolu le mystère. Ancien membre des services secrets argentins, Ignacio a trouvé un nouveau poste dans l’équipe de sécurité privée de La Salada. Depuis plusieurs années, il vient trois fois par semaine, les jours de marché, patrouiller dans son secteur de ce site de 18 hectares, situé juste derrière la limite sud de la ville de Buenos Aires. Aujourd’hui, La Salada est un assemblage délabré de trois grands hangars et d’innombrables rues résidentielles, dont les maisons ont été converties en entrepôts de stockage. Les rues sont envahies en permanence de stands en grillage. D’ordinaire plutôt taciturne en entretien, Ignacio a eu une réaction remarquable lorsque nous l’avons interrogé sur l’avenir de La Salada. De plus en plus animé, il a expliqué avec une évidente excitation comment le deuxième étage en construction de l’un des hangars allait non seulement être terminé, mais complété par trois niveaux supplémentaires. Ce centre commercial de cinq étages aurait alors une colonne centrale d’escalators, comme les centres légaux situés au cœur de Buenos Aires. Ce serait un exemple de réussite pour tout le pays ! Comme il parlait, l'origine de l’activité frénétique de La Salada devint évidente : l’espoir. Ignacio poursuivait le rêve américain, comme tout le monde, mais comptait y parvenir par le biais d’un marché informel et illégal.

© Photographie de Sarah Pabst
Juan, lui aussi, était optimiste. Après avoir été chassés de l’atelier de son oncle, sa famille et lui ont monté leur propre affaire de vêtements. Il loue aujourd’hui un stand à La Salada trois jours par semaine et passe trois autres jours à couper et coudre dans son atelier, chez lui. Comme les acheteurs, Juan, le migrant bolivien, n’est pas de Buenos Aires. Pourtant, les semaines de six jours de Juan l’ont enchaîné à la ville, avec sa famille, et les obligent à compter sur la mobilité de leurs clients. Leur espoir est qu’un jour tout ce dur labeur soit récompensé par assez d’argent et de sérénité face à l’avenir pour s’offrir une semaine de vacances hors de la ville et acheter leur propre maison dans un quartier plus agréable. Leur modèle est la classe moyenne de Buenos Aires, des propriétaires habitués à partir en vacances, à se rendre dans des centres commerciaux classiques pour acheter des habits fabriqués en partie dans des ateliers clandestins et en partie dans ce qu’il reste de l’industrie légale du vêtement.
La production argentine de prêt-à-porter a été presque anéantie dans les années 1980, lorsque les innovations dans le domaine des communications et de la technologie, les accords commerciaux, les politiques néolibérales, les flux migratoires et la baisse du coût du transport ont décimé le secteur. Alors que les usines étaient déplacées pour profiter du faible coût de la main d’œuvre en Asie, des milliers d’Argentins se sont trouvés sans emploi légal et ont dû chercher du travail dans le secteur informel.

© Photographie de Sarah Pabst
Nous avons rencontré Juan sur son stand de La Salada, qui débordait de vêtements Adidas contrefaits. Il nous a expliqué fièrement qu’il concevait et produisait tout lui-même chez lui. D’après nos recherches, les 8 000 stands comme celui de Juan sont approvisionnés par environ 31 000 ateliers mais ceux-ci, loin des immenses usines asiatiques que nous imaginions, sont des petites fabriques situées dans les arrière-boutiques et « employant » rarement plus de 20 personnes. Comme dans le cas de Juan, nombre de ces « employés » sont en fait des membres de la famille, qui ne reçoivent pas de salaire mais partagent les bénéfices – ou pertes – de l’activité. Le marché est un lieu dangereux, comme en témoignent Ignacio et Juan. Des voleurs ciblent les marchands distraits (Juan s’est fait voler l’équivalent d’une semaine de produits un jour où il a tourné le dos un moment) et les nombreux gangs criminels et escrocs professionnels mobilisent en permanence le personnel de sécurité. Nous nous sommes demandé comment les gens pouvaient être si optimistes dans un lieu pareil.
C’est seulement après plusieurs mois passés avec lui sur son stand que Juan nous a invités à venir voir son atelier. Cette visite nous a appris à la fois la diversité des dangers auxquels ces travailleurs sont exposés et l’étendue des moyens auxquels ils doivent recourir pour se protéger dans un tel climat de défiance. Même après des mois de collaboration, Juan craignait encore que nous ne soyons des policiers en civil. Pour tester cette hypothèse, il nous a donné une fausse adresse, qui nous a lancés dans un jeu de piste à travers certains des quartiers les plus dangereux du Grand Buenos Aires. Finalement, Juan nous a donné sa véritable adresse, car notre persévérance semblait prouver à ses yeux que nous n’étions ni des policiers en opération secrète ni des espions cherchant à renseigner ses rivaux.

© Photographie de Sarah Pabst
Ce que nous avons trouvé, en arrivant, était une oasis d’espoir. Malgré le danger toujours présent des descentes de police (les propriétaires d’ateliers essaient d’éliminer la concurrence en fournissant à la police les adresses de leurs rivaux), l’atelier étonnamment moderne et bien équipé était un lieu où Juan et sa famille pouvaient laisser libre cours à leur imagination. Avec sa mère, son père, son frère et sa sœur, il appréciait le processus créatif consistant à concevoir et fabriquer de nouveaux vêtements, et inventait de nouveaux stratagèmes pour gravir l’échelle sociale – en plus du stand de vêtements au marché, la famille prévoyait d’ouvrir une boutique de fournitures pour vendre des fermetures éclairs, des boutons, et autres produits essentiels pour les propriétaires d’ateliers. Tous ceux qui prenaient part à la chaîne de fabrication enfreignaient un nombre considérable de lois sur le travail et les impôts, produisant souvent des vêtements en violation du droit de propriété intellectuelle, comme les « Adidas » faits maison de Juan. Gagner sa vie, dans un tel contexte d’illégalité et d’informalité, revient à s’enfermer dans un cycle sans fin de découpe de patrons, de couture, de vente et de coordination avec les autres ateliers. Il était facile de comprendre pourquoi Juan se voyait comme un « esclave ». Pourtant, tout cela était porté par l’espoir : en vendant des contrefaçons fabriquées dans des ateliers clandestins, les travailleurs de La Salada espèrent acquérir richesse matérielle et reconnaissance sociale.

© Photographie de Sarah Pabst
La Salada offre aussi de l’espoir aux acheteurs : les grossistes qui viennent à Buenos Aires et les milliers de foyers pauvres qui ne peuvent pas acheter des vêtements ailleurs que chez ces commerçants. Les centres commerciaux qu’Ignacio souhaite tant égaler ont porté le prix du prêt-à-porter au-delà de ce que peuvent s’offrir de nombreux Argentins. L’augmentation des prix est également due à la « course à la qualité » des fabricants légaux, les produits plus chers étant la seule niche permettant de concurrencer les importations asiatiques à bas prix. À présent que les politiques protectionnistes ont jugulé ces importations, le marché de La Salada peut les remplacer et fournir des produits abordables, imitant des marques prestigieuses, aux familles aux revenus moyens à faibles. Le coût humain s’observe dans les conditions déplorables subies par les travailleurs des ateliers clandestins, qui se décrivent eux-mêmes comme des « esclaves » du marché tout en s’accrochant à l’inébranlable espoir que celui-ci leur permette d’accéder à un avenir meilleur. On remarque, toutefois, que La Salada ne fait plus partie de cet avenir : parmi les personnes avec qui nous avons réalisé des entretiens, aucune ne souhaite la même vie pour ses enfants. Ainsi, la durabilité de l’économie du vêtement qui gravite autour de La Salada est incertaine – l’espoir qui porte la génération actuelle ne portera plus la suivante. Pourtant, si Juan parvient à gravir l’échelle sociale, il reste assez de gens, plus bas, pour prendre sa place : en Argentine comme en Bolivie, le travail clandestin représente, pour beaucoup, une progression.
Autres publications